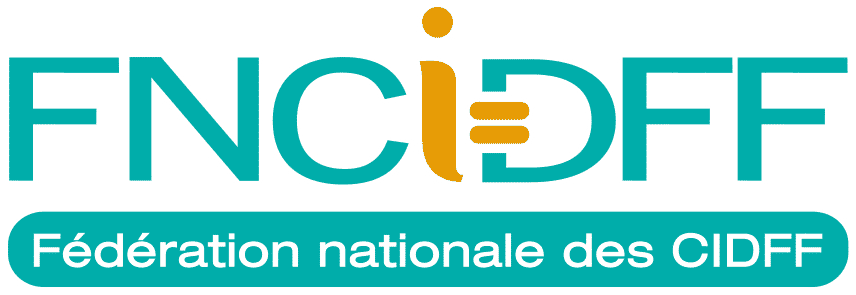Plusieurs femmes témoignent de violences subies en consultation et se désolent que leur parole ne soit pas autant considérée que celle des médecins.
par Cassandre Leray publié le 8 août 2022
Chaque mot lui fait «l’effet d’une gifle». Leïla fait défiler les tweets. Elle ne supporte plus de «voir autant de gens dire que les victimes de violences gynécologiques exagèrent». En 2014, dans un hôpital parisien, une interne en médecine lui a «enfoncé une sonde dans le vagin» par surprise, pour procéder à une échographie. Leïla avait pourtant refusé l’examen. «Je lui ai dit en pleurant que j’avais mal, que je voulais qu’elle arrête, j’ai tenté de repousser sa main. Mais elle m’a dit d’arrêter d’exagérer et a continué.» Alors, quand Leïla lit une énième fois que ce qu’elle et d’autres ont vécu n’est pas une violence, elle ne peut plus retenir ses larmes. «C’est comme crier dans le vent sans qu’on nous entende. Je sais faire la différence entre un examen douloureux et une violence sexuelle.»
Consentement indispensable
Nolwenn (1) a 40 ans. Aujourd’hui chargée de communication à Rennes, elle se souvient encore de sa toute première consultation chez une gynécologue en Bretagne. A l’époque, elle n’est «pas active sexuellement». Elle vient seulement pour obtenir une pilule contraceptive, obligatoire dans le cadre de la prise du traitement Roaccutane, un médicament contre l’acné. En quelques minutes, elle se retrouve complètement nue, les pieds dans les étriers. «Elle m’a fait une palpation des seins, un toucher vaginal et un toucher rectal. Je n’avais que 12 ans.» Nolwenn ne sait pas si cet examen est nécessaire, ni à quoi il sert, elle n’a d’ailleurs aucune idée de ce qu’est un toucher vaginal en passant la porte du cabinet. C’est seulement quelques décennies plus tard qu’elle comprend que «cette auscultation était complètement inappropriée». «On a l’impression d’être comme une bagnole au garage, sans jamais savoir ce qui va nous arriver.»
Les femmes contactées par Libération veulent déconstruire ces discours affirmant qu’elles savent à quoi s’attendre en venant chez un gynécologue : non, elles ne savent pas toujours. Surtout, quoi qu’il en soit, leur accord reste indispensable. Sauf en cas d’urgence médicale, le consentement doit être recueilli avant chaque examen. Une obligation consacrée par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Sur les réseaux sociaux, «on peut pourtant lire que prendre rendez-vous ou s’allonger sur une table font office de consentement. Mais non, ça ne marche pas comme cela», lâche Rose (1), 30 ans, streameuse sous le pseudo Zul’Zorander.
A ses 18 ans, elle consulte un gynécologue pour une endométriose – une maladie gynécologique provoquant notamment d’intenses souffrances lors des règles – à un stade très avancé. Elle est allongée sur une table d’examen, dénudée, quand le médecin «[lui] dit qu’il ne veut pas déflorer une vierge et va donc procéder à un toucher rectal plutôt que vaginal. Sans me demander, il me met deux doigts dans l’anus pendant cinq minutes de douleur. C’est un viol». Devant deux étudiants en médecine dont elle n’avait «pas autorisé la présence» et sa mère, en pleurs, qui l’accompagne. «Personne n’imagine qu’un professionnel de santé peut commettre des violences. Si c’est un inconnu, c’est un viol. Mais si c’est un médecin, on ne nous croit pas», s’indigne la jeune femme.
Un problème de santé publique
Face à un tel état des lieux, certaines femmes tentent tant bien que mal de partir en quête d’un ou d’une professionnelle de confiance. Margot (1), 23 ans, étudiante en sciences politiques à Paris, est passée par la liste de soignants et soignantes féministes Gyn & co après un rendez-vous qui l’avait «dégoûtée» quelques années plus tôt : «Sans rien m’expliquer, la gynécologue m’a fait un toucher vaginal hyper douloureux alors que j’étais complètement nue.» C’est en se tournant vers une nouvelle praticienne qu’elle apprend qu’une auscultation «n’est pas nécessaire à chaque fois». «C’est désolant d’avoir à fouiller pour espérer trouver une gynéco qui nous traite bien, alors que ça devrait être normal», ajoute-t-elle, dépitée.
Pour certaines, le traumatisme est tel qu’elles cessent tout suivi gynécologique pendant des années. Comme Amandine (1), 21 ans, aujourd’hui étudiante en lettres à Rennes. A 17 ans, elle se rend dans un laboratoire pour un prélèvement vaginal. L’infirmière lui insère alors un speculum dans le vagin «sans [la] prévenir» : «Je ne savais pas ce que c’était, je n’avais jamais fait de prélèvement. Je pleurais et je tremblais de douleur car je suis atteinte de vaginisme, mais elle ne me répondait pas.» S’en suit une longue période durant laquelle elle est incapable de se rendre chez un médecin pour tout problème gynécologique, de peur de subir la même chose.
(1) Les prénoms ont été modifiés.